L’autorité, c’est LA communication
- April 2025
- Eric Camel
Certains discours politiques ou médiatiques s’érigent en défenseurs de l’autorité, comme s’il s’agissait d’un principe magique permettant de restaurer l’ordre perdu. Ces discours se contentent souvent de slogans : “Il faut rétablir l’autorité”, “les jeunes ne respectent plus rien”. On convoque une autorité sans sujet, sans contenu, sans finalité. Cette vision, régressive et dépolitisée, empêche de penser ce que pourrait être une autorité émancipatrice.
L’autorité : un principe d’autonomie et des responsabilité
Or, l’étymologie nous offre une voie plus fertile : auctoritas, en latin, vient de augere : faire croître. L’autorité n’est pas la domination ; elle est ce qui fait grandir. Elle est ce qui permet aux autres de devenir auteurs à leur tour, en les accompagnant dans leurs choix et leurs compréhensions. Elle est liée à l’expérience, à la compétence, à la responsabilité.
Comme l’écrit Michel Serres : « L’autorité “coup de bâton” n’est que le décalque des conduites animales, celle du mâle dominant chez les éléphants de mer ou les chimpanzés. C’est pourquoi, quand je vois un patron avec son staff autour, plein de courbettes, je ne peux m’empêcher de penser aux ruts des wapitis dans les forêts de Californie du Nord. Cette autorité-là fait marcher les sociétés humaines comme des sociétés animales. Heureusement, la culture humaine a remplacé le schéma animal. La morale humaine augmente la valeur de l’autorité..
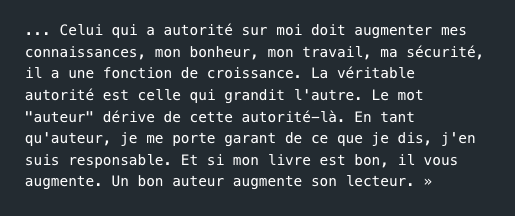
Pensée ainsi, l’autorité devient un principe d’autonomisation. Elle ne contraint pas, elle encadre. Elle ne se proclame pas, elle s’incarne. En communication, elle opère comme une forme de pédagogie du sens : elle aide à comprendre, à choisir, à situer les messages dans un contexte plus large.
L’autorité : une réponse aux désordres de l’écosystème digital
Le digital a démocratisé l’accès à la parole, mais cette abondance de contenus n’a pas produit une abondance de sens. Au contraire, elle a engendré une fatigue informationnelle croissante. Trop de sources, trop de bruits, trop de contradictions. Selon une étude de Reuters Institute (2023), 36 % des internautes évitent activement les actualités, jugeant le flot d’informations anxiogène ou débordant. Dans cet environnement déroutant, ce que les publics cherchent n’est plus tant l’information que l’orientation.
C’est ici que la notion d’autorité retrouve toute sa pertinence. Elle permet de distinguer ce qui est digne d’être écouté de ce qui relève du bruit. Les plateformes elles-mêmes l’ont compris. Google, par exemple, a intégré dans son algorithme des critères EEAT : Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness. L’autoritativeness devient un critère-clé pour qu’un contenu soit jugé pertinent, fiable, visible.
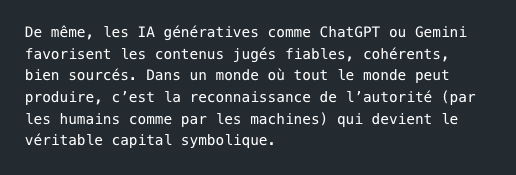
Autres signes convergents : le déclin de certaines formes d’influenceurs au profit de figures plus expertes ; la montée des podcasts explicatifs, des newsletters contextualisées, des formats longs. L’attention est rare, donc elle se porte sur ceux qui savent la mériter.
L’autorité : le nouveau graal de la communication
Loin d’être une nostalgie de l’ordre, l’autorité en communication est une condition de compréhension, d’engagement et de responsabilité. Elle n’est pas l’ennemie de la liberté ; elle en est le cadre le plus fécond. Encore faut-il en faire une stratégie claire et assumée.
Quatre leviers concrets pour les entreprises :
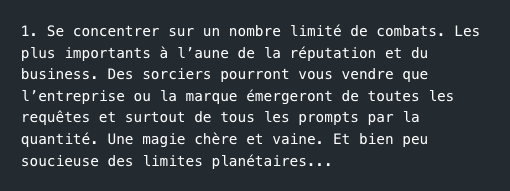
2. Séduire et faire émerger des figures d’autorité : experts (les nouveaux «influenceurs». ?), dirigeants,salariés porte-parole… Des voix constantes, cohérentes, capables de créer du lien dans la durée.
3. Incarner l’autorité par les formats : préférer les formats explicatifs, contextuels, narratifs. Moins de bruit, plus de profondeur.
4. Travailler les signaux d’autorité numérique : citations croisées, références stables, vocabulaire cohérent. Créer une trace lisible dans l’écosystème informationnel, aussi bien pour des humains que pour des IA devenues incontournables.
Faire autorité aujourd’hui, ce n’est plus imposer une voix unique, c’est proposer un cadre stable, lisible, interprétable. C’est ouvrir l’espace de la décision, pas le refermer. Bref, c’est rendre chacun un peu plus auteur de ses choix.